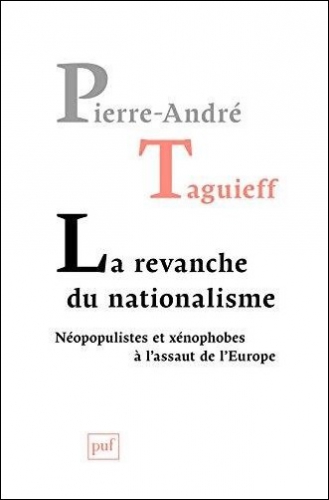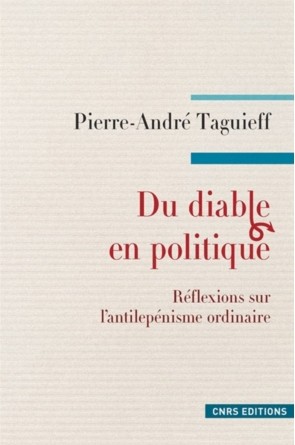FigaroVox: Votre livre décrit la mécanique diabolisatrice à l'œuvre dans le paysage politique français depuis trente ans, qui renvoie systématiquement le Front national aux «heures les plus sombres» et à la «bête immonde». Pouvez-vous nous décrire ce processus de diabolisation?
Pierre-André TAGUIEFF: La diabolisation implique de réduire un individu ou un groupe à une manifestation du Mal ou à une incarnation du diable, et d'en tirer les conséquences pratiques, à savoir l'élimination de l'entité diabolisée. Dans les systèmes totalitaires, la diabolisation des opposants se traduit par leur extermination physique. Dans les démocraties pluralistes, les adversaires diabolisés sont en principe exclus du jeu démocratique, mis à l'écart du système politique. La diabolisation constitue ainsi une méthode d'illégitimation d'un adversaire, d'un concurrent, d'un contradicteur, qui sont ainsi transformés en ennemis redoutables et haïssables. En outre, diaboliser l'autre (l'opposant ou le différent), c'est se classer soi-même dans la catégorie des représentants ou des combattants du Bien. C'est donc se donner une légitimité, voire une respectabilité à bon compte.
Lorsqu'elle prend pour cible le Front national, la diabolisation consiste à retourner contre ce parti ses propres méthodes de combat idéologique. Comme la plupart des mouvements nationalistes, le FN diabolise ses ennemis en les désignant, d'une part, en tant que responsables du désordre à l'intérieur de la nation, un désordre facteur d'affaiblissement ou de déclin, et, d'autre part, en tant qu'incarnant une menace pour la survie de la nation. Disons, pour préciser, que le désordre intérieur est attribué à une immigration jugée non intégrable, et que la mondialisation et la construction européenne sont dénoncées comme des menaces pesant sur l'indépendance et l'identité nationales. Mais si les nationalistes diabolisent les ennemis du peuple, à l'intérieur, ou ceux de la nation, à l'extérieur, ils sont eux-mêmes fortement diabolisés en retour, étant accusés notamment d'être partisans de la fermeture sur soi de la nation, de se montrer xénophobes ou racistes, et surtout d'être des fauteurs de guerre, en alimentant les peurs et les haines entre groupes, ou en diffusant la vision d'un conflit «naturel» entre les nations définies comme rivales. En France, l'antinationalisme est devenu idéologiquement hégémonique à la faveur de la construction européenne. Les nations étant perçues comme des obstacles à cette dernière, le sentiment national lui-même a été réduit par les élites dirigeantes et discutantes à une survivance nuisible d'un passé heureusement révolu, à un archaïsme détestable. Le problème, c'est que le sentiment de l'appartenance nationale, qui revient à celui de posséder une identité nationale, n'a nullement disparu de l'opinion, et, plus profondément, des mentalités ou des croyances culturelles. À partir de 1983-1984, le mouvement lepéniste a incarné tout ce rejetaient et méprisaient les élites antinationalistes ainsi que les héritiers de gauche du vieil antifascisme. D'où la dénonciation du FN comme «fasciste», stigmatisation qui l'a isolé dans le système des alliances politiques. Mais, en même temps, le FN a pu s'efforcer, non sans succès, de monopoliser le sentiment national dans tous ses aspects. Ainsi, à la diabolisation par le FN a répondu celle du FN, faisant surgir un cercle polémique vicieux qui ne cesse de compliquer l'interaction entre le FN et ses ennemis, et d'engendrer des effets pervers.
La «reductio ad Hitlerum» avait déjà été dénoncé par Leo Strauss en son temps. Qu'apporte votre livre de nouveau?
En 1953, au début de son grand livre intitulé Droit naturel et histoire, Leo Strauss, agacé par les clichés d'une rhétorique antifasciste fonctionnant à vide et devenue l'instrument privilégié du terrorisme intellectuel, avait pointé le problème en donnant une dénomination suggestive à ce qui lui paraissait être un raisonnement fallacieux: «reductio ad Hitlerum». Dans un contexte où l'antifascisme consensuel était devenu une forme de conformisme idéologique justifiant tous les amalgames polémiques, le philosophe juif émigré aux Etats-Unis faisait cette mise en garde d'ordre méthodologique: «Il n'est malheureusement pas inutile d'ajouter qu'au cours de notre examen nous devrons éviter l'erreur, si souvent commise ces dernières années, de substituer à la reductio ad absurdum la reductio ad Hitlerum. Qu'Hitler ait partagé une opinion ne suffit pas à la réfuter.» L'accent est mis sur la valeur de vérité d'un énoncé quelconque. Disons, pour simplifier la question à des fins pédagogiques, que la reductio ad Hitlerum consiste pour Strauss à juger fausse toute assertion, comme «La Grande-Bretagne est une île», que le Führer croyait vraie. Inférence illustrant à quel point l'endoctrinement idéologique peut rendre stupides ceux qu'il aveugle. Il s'agissait d'ailleurs pour Strauss d'une remarque marginale dans un livre de philosophie politique consacré notamment à la discussion des thèses de Max Weber, ce qui explique qu'il n'ait pas développé l'analyse du type d'amalgame polémique qu'il avait brièvement caractérisé, à savoir la diabolisation de type antifasciste. Car aujourd'hui, lorsqu'on dénonce à juste titre la reductio ad Hitlerum, on vise un sophisme beaucoup plus pernicieux, qu'on peut illustrer par ce syllogisme défectueux: «Hitler aimait les chiens (ou Wagner) ; X aime aussi les chiens (ou Wagner) ; donc X est un disciple d'Hitler». Je soulignerai au passage le fait que diaboliser un individu ou un mouvement politique quelconque en l'assimilant à Hitler ou au nazisme, c'est banaliser le nazisme.
C'est à Léon Poliakov qu'on doit l'analyse pionnière de la diabolisation, mode de fabrication d'ennemis absolus. Mais, dans ses travaux des années 1970 et 1980 sur la «causalité diabolique», l'historien de l'antisémitisme avait surtout étudié la diabolisation des Juifs, des jésuites et des francs-maçons, à travers les «théories du complot» qui les prenaient pour cibles. Dans l'après-1945, ce sont principalement les nationalistes, eux-mêmes grands diabolisateurs de leurs adversaires, qui ont été diabolisés par leurs ennemis, qui les percevaient comme des héritiers des fascistes ou des nazis.
L'assimilation abusive d'un quelconque adversaire à Hitler, pris comme incarnation du diable, en vue de le disqualifier, reste une opération rhétorique banale, qu'on peut observer aujourd'hui dans les affrontements politiques, voire dans les débats intellectuels en Europe et ailleurs. Le discours antifasciste continue de fonctionner en l'absence de fascismes réels, ce qui pousse les diabolisateurs à inventer sans cesse de nouveaux fascismes imaginaires. Cette bataille contre des néo-fascismes fictifs relève de ce que j'ai appelé le néo-antifascisme, dont l'antilepénisme ordinaire est, en France, la principale figure. Dans mes analyses des amalgames polémiques en politique, je distingue quatre principes de réduction de l'adversaire qu'il s'agit de transformer en ennemi répulsif, méprisable ou haïssable, à exclure ou à neutraliser: le diabolique (ou le démoniaque), le bestial, le criminel et le pathologique. D'où autant de manières de dénoncer les figures du Mal politique: diabolisation, bestialisation, criminalisation et pathologisation. Dans le discours antilepéniste «classique», on retrouve, diversement combinées, ces quatre stratégies de délégitimation. Mais ce discours, adapté à la personnalité de Jean-Marie Le Pen dont il caricature certains traits de caractère ou de comportement, s'est avéré moins crédible face à celle de Marine Le Pen. C'est ce qui explique en partie la relative et récente normalisation du FN. Celle-ci illustre la perte d'efficacité symbolique de la rhétorique néo-antifasciste en France, en même temps qu'elle nous rappelle l'importance de la personnalité des leaders politiques imaginée à travers leur visibilité médiatique.
L' «antilepénisme ordinaire» a-t-il fonctionné contre le Front national comme l'espéraient ses initiateurs?
Fondé sur la diabolisation et l'appel au front républicain, conformément à la tradition antifasciste, l'antilepénisme standard, s'il a pu contenir provisoirement le FN en l'empêchant de conclure des alliances avec les partis de droite, a engendré nombre d'effets pervers dont témoigne son actuel dynamisme. C'est par la diabolisation de Jean-Marie Le Pen que ce dernier est devenu célèbre et que le FN est sorti de la marginalité. Ce maître de la provocation qu'est Le Pen a su prendre la posture du diabolisé, la mettre en scène comme une injustice ou une forme de persécution, attirer ainsi la compassion ou la sympathie, et finir par retourner l'attaque en composante de son charisme. Les antilepénistes n'avaient pas prévu que leur cible principale pourrait se présenter glorieusement comme une victime injustement accusée et comme un héros, un «résistant», voire comme un héritier de la «Résistance», face aux nouveaux ennemis supposés de la France. En outre, l'antilepénisme diabolisateur a eu pour effet d'installer le FN au centre de la vie politique française, de fixer l'attention inquiète de tous les acteurs politiques sur son évolution à travers les élections et les sondages. Depuis la fin des années 1980, la France politique a semblé vivre à l'heure du FN.
Répéter un slogan aussi dérisoire que «F comme fasciste, N comme nazi», totalement décalé par rapport à la réalité du mouvement lepéniste, c'était courir à l'échec: un tel excès dans l'accusation a rendu celle-ci insignifiante. Et ce, d'autant plus que l'image de Marine Le Pen s'est montrée imperméable à ces attaques hyperboliques. Le FN a fini par retourner à son profit la stigmatisation: la victime présumée du «Système» s'est posée en alternative globale à ce dernier, et ce, d'une façon crédible pour une importante partie de l'opinion. Bref, la propagande antilepéniste, qui se proposait de faire disparaître le FN de l'espace politique français ou de le marginaliser fortement, aura globalement joué le rôle d'un puissant facteur de la montée du FN. Paradoxe comique pour les uns, tragique pour les autres.
Votre livre n'arrive-t-il pas trop tard, après que la stratégie de dédiabolisation engagée par Marine Le Pen après 2002 a porté ses fruits? (34% des Français déclarent adhérer aux valeurs du Front national). L'antifascisme que vous décrivez n'est-il pas une attitude médiatique résiduelle?
Je ne le crois pas. D'une part, la normalisation du FN est loin d'être achevée: la figure de Marine Le Pen reste fortement rejetée, dès lors qu'elle ne symbolise plus seulement une opposition radicale au pouvoir socialiste. D'autre part, faute d'imagination, la gauche et l'extrême gauche sont vouées à répéter pieusement, d'une façon commémorative, les rites de conjuration du Mal politique. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, un discours de propagande ne disparaît pas pour la seule raison qu'il est devenu inefficace. Car il peut faire tradition, comme c'est le cas pour le discours antifasciste, dont les versions successives constituent autant de recyclages. La tradition, c'est ce qui se répète, en rassemblant et rassurant une communauté de croyants ou de militants. En outre, la relative normalisation du FN n'est pas le simple effet de la décision prise par Marine Le Pen, reprenant sur ce point le projet défini par Bruno Mégret dans les années 1990, de «dédiaboliser» le FN. On ne se «dédiabolise» pas à volonté: de multiples facteurs sont en jeu dans l'affaire, qui ne dépendent pas seulement des désirs de tel ou tel leader, aussi bon stratège idéologique soit-il. Le retrait progressif de Jean-Marie Le Pen est simplement dû à l'âge avancé du personnage provocateur. Il a provoqué un appel d'air pour le parti qu'il plombait. Le renouvellement et le rajeunissement des cadres, des adhérents et des sympathisants du FN, à l'image de Marine, ont joué un rôle majeur. Quant au contexte des années 2000, de la prise de conscience de la menace islamiste à la perte de confiance dans les élites nationales européistes, en passant par l'expérience inquiétante de la crise financière de 2008, qui a favorisé le retour de l'anticapitalisme et la diffusion des idées protectionnistes, il a globalement profité au nouveau FN. Dos au mur, les ennemis du FN continuent de lancer leurs anathèmes et de proférer leurs injures ou leurs imprécations rituelles (le FN «fasciste», «d'extrême droite», «raciste», etc.), rêvant toujours de faire interdire le parti qu'ils prétendent, depuis trente ans, éliminer de l'espace politique. Ils ne veulent pas discuter, critiquer, argumenter, ils rêvent de brûler les nouveaux hérétiques. À la force du préjugé s'ajoute celle de l'habitude, qui, chez les âmes mortes, est l'unique principe d'action. Une âme morte, disait Péguy, est une «âme extrêmement habituée».
N'y a t-il pas derrière ce discours angélique de l'antilepénisme primaire une stratégie plus cynique consistant faire monter le FN pour diviser la droite et affaiblir la droite traditionnelle?
C'est en effet l'une des hypothèses que je retiens. Contrairement aux apparences, le néo-antifascisme ne se réduit pas à une posture morale inefficace censée être honorable, il constitue une stratégie politique. L'un des objectifs du néo-antifascisme instrumentalisé par la gauche, c'est de restructurer l'espace politique autour d'un affrontement entre le PS et le FN, ce qui suppose un FN fort et une UMP affaiblie. Il s'agit donc de favoriser par divers moyens le dynamisme du FN tout en provoquant l'explosion de l'UMP, minée par ses divisions idéologiques et la rivalité de ses dirigeants. L'objectif est de faire disparaître la droite libérale comme force politique concurrente du PS. Il avait été formulé à la fin des années 1980 par les antiracistes mitterrandiens: faire qu'il n'y ait «rien entre le FN et nous». Ce qui supposait un double processus: le ralliement d'une grande partie de la droite (une fois en miettes) à l'extrême droite, et la redéfinition de l'extrême droite forte comme représentant la (nouvelle) droite. C'est la raison pour laquelle les stratèges machiavéliens du PS, formés à l'école mitterrandienne, ne s'émeuvent guère de la «montée du FN», ni de l'échec de la diabolisation qu'ils ont privilégiée en tant que stratégie anti-FN, et qui a contribué à ladite «montée». Ils savent que le seul moyen de gagner l'élection présidentielle de 2017, malgré l'impopularité de la gauche au pouvoir, c'est de faire précisément «monter» le FN pour provoquer l'élimination au premier tour du principal candidat de droite libérale, avant de l'emporter face à une Marine Le Pen jugée incapable de rassembler suffisamment, et rejouant ainsi malgré elle, mutatis mutandis, le rôle de son père en avril 2002. Le «front républicain», en tant que front du refus coalisant toutes les forces rejetant absolument le FN, ne peut vraiment fonctionner qu'au deuxième tour d'une élection présidentielle.
Les machiavéliens de gauche, lucides et cyniques, qui misent sur le renforcement du FN, savent qu'il suffit pour cela de le combattre d'une façon magique en suivant la stratégie diabolisatrice qui l'a rendu attractif. À cet égard, on notera que le PS et le FN ont des objectifs convergents, à commencer par l'éclatement de l'UMP, suivi par le ralliement d'une partie des cadres et des adhérents à gauche ou au centre, et d'une autre partie au FN. Le nouveau bipartisme opposerait une droite nationale à une gauche européiste.
«Totalement dédiabolisé, le FN perdrait une grande partie de son attractivité», écrivez-vous. Pourquoi le «diable» attire-t-il tant en politique?
Dans le charisme politique, il y a nécessairement une dimension démoniaque, perçue autant par les admirateurs du chef charismatique que par ses ennemis. Les grands démagogues et les pires dictateurs sont dotés d'un fort charisme. Ils sont porteurs d'une promesse de rupture salvatrice et de changement bénéfique. Ils sont perçus dans l'ambivalence: on attend d'eux de grandes choses, car ils promettent que l'impossible est désormais possible, et la déception qu'ils finissent par provoquer est d'autant plus profonde. L'admiration amoureuse se retourne souvent en haine et en ressentiment. Or, le propre du FN comme entreprise politique familiale, c'est qu'il existe en raison du charisme de ses dirigeants, Le Pen père ou Le Pen fille. Ils ne sont pas jugés sur leur action politique ou leur gestion des affaires publiques, mais sur leur discours de combat, leurs intentions affichées, leurs promesses alléchantes et tranchantes. Qui ne reconnaît les multiples menaces pesant sur la société française? Qui n'est pas d'accord avec le projet de «sauver la France»? Mais, pour séduire, il faut présenter un visage qui se distingue fortement de la masse grégaire des acteurs politiques formatés. La mal-pensance affichée des leaders du FN fait partie de leur prestige ou de leur capital symbolique, elle les distingue des autres leaders politiques. Sans écart socialement visible et régulièrement affirmé par rapport à la norme idéologique et politique, sans sa dimension «luciférienne», le FN ne pourrait exercer la moindre séduction. Il lui faut faire peur à certains pour attirer les autres. Donc alimenter en permanence une réputation de non-conformisme. Il y a là une stratégie d'auto-stigmatisation ou d'auto-diabolisation plus ou moins contrôlée (d'où ce qu'il est convenu d'appeler les «dérapages», inévitables). Les démagogues à l'eau de rose, ou couleur rose bonbon, sont dénués d'attrait. Ils ne produisent ni amour, ni haine. Après leur petite heure de célébrité médiatique, ils disparaissent rapidement dans le trou noir de leur affligeante normalité.
Vous dénoncez dans votre livre la dissymétrie entre une «extrême droite» diabolisée et une extrême gauche pardonnée de ses excès. D'où vient ce «deux poids deux mesures»?
C'est là un héritage de l'antifascisme soviétique, dont les idéologues et propagandistes, depuis les années 1950, n'ont cessé de marginaliser ou de calomnier en France la position antitotalitaire ou anti-extrémiste pour camoufler la criminalité du communisme, et permettre à la gauche de se «ressourcer» régulièrement en revenant à Marx ou à tel ou tel théoricien révolutionnaire et anticapitaliste (Lénine, Trotski, Gramsci, etc.). Il importe à une partie de la gauche de laisser ouverte la voie d'un retour éventuel à l'idée communiste, donc de ne pas diaboliser le communisme, en dépit de ses crimes, comme elle diabolise le fascisme, et plus particulièrement le nazisme. Cette gauche nostalgique suppose que l'idée ou l'utopie communiste est bonne en elle-même, et que seules ses réalisations historiques ont échoué. Alors qu'elle postule que le nazisme est en lui-même un mal, qu'il incarne même le Mal absolu. Ce traitement asymétrique est caractéristique de l'antifascisme dans toutes ses variantes, et nous rappelle que, comme l'avait bien vu George Orwell, la gauche est antifasciste mais non antitotalitaire. J'ajouterai qu'elle voit le «fascisme» là où il n'est pas (Raymond Aron et le général de Gaulle ont été traités de «fascistes»), et que, simultanément, elle ne voit pas le fascisme où il est, par exemple dans le chavisme tant admiré par Jean-Luc Mélenchon. Une admiration partagée par le polémiste Alain Soral qui se définit lui-même, pas seulement par provocation, comme «national-socialiste».
«Nous vivons dans un univers de spectres, où aux fascismes imaginaires font écho des antifascismes imaginaires d'aujourd'hui», écrivez-vous. Pourquoi l'antifascisme idéologique a-t-il survécu à la mort du fascisme politique alors que l'anticommunisme a, lui, disparu suite à l'effondrement du bloc soviétique?
L'antifascisme imaginaire, ou si l'on préfère l'imaginaire antifasciste, dont la diabolisation du fait national est aujourd'hui la principale illustration, c'est ce qui reste du communisme dans les esprits. L'antinationalisme est progressivement devenu la principale reformulation du vieil antifascisme. Mais les antinationalistes en sont venus à diaboliser la nation comme telle. C'est ce que j'ai appelé naguère, au début des années 1990, l'«antinationisme», qui s'est transformé en idéologie dominante dans les milieux européistes. La projection sur la nation de tous les traits répulsifs du «fascisme» en est le principe moteur. Dans la rhétorique de combat centrée sur la dénonciation des «eurosceptiques» ou des «europhobes», c'est bien le sentiment national qui est incriminé, au point d'être criminalisé. De la même manière, la reformulation antiraciste de l'antifascisme, qui se traduit principalement par la célébration de l'immigration comme méthode de salut, est centrée sur la diabolisation de la nation comme identité collective et souveraineté. Comme l'existence même des frontières nationales, la distinction simple entre nationaux et étrangers est considérée par les «antinationistes» comme un scandale. Pour ces nouveaux utopistes, il faut que disparaissent les États-nations pour que l'humanité s'unifie à travers la multiplication des processus migratoires sans contrôles ni limites. Leur rêve est d'instaurer une démocratie cosmopolite, dans un espace post-national qu'ils s'efforcent de construire en délégitimant le sentiment national tout en érigeant l'immigration de masse en fatalité et en phénomène intrinsèquement bon ou bénéfique.
Il faut relever ce grand paradoxe: alors que jamais, depuis 1945, le nationalisme ne s'est mieux porté en Europe, la diabolisation du nationalisme et du sentiment national est devenue la posture idéologique dominante dans le monde des élites. Si un fait observable prouve la coupure entre les peuples et les élites, entre les «localisés» d'en bas et les «mondialisés» d'en haut, entre les «enracinés» et les «nomades», c'est bien celui-là. La diabolisation néo-antifasciste de la nation est contre-productive à l'heure où l'Union européenne ne fait plus rêver la majorité des Français, qui doutent majoritairement des vertus de l'euro.
Un autre paradoxe saute aux yeux, et fait sourire. Chassé par la porte au nom de la morale, le nationalisme revient par la fenêtre au nom du réalisme politique. Dans leurs attaques contre le FN, les antinationalistes déclarés prétendent monopoliser l'attachement patriotique et incarner les «valeurs de la France». Ils retournent ainsi la chimère de «l'anti-France» contre les nationalistes français qui l'avaient beaucoup utilisée. Le sentiment national supposé honteux quand il est attribué au FN se transforme soudainement en une légitime fierté d'être français, claironnée par les dénonciateurs occasionnels de «l'anti-France» nouvelle à visage lepéniste. On ne compte plus les leaders politiques et les intellectuels s'indignant publiquement de l'existence d'une «extrême droite» qui, selon eux, véhicule des idées qui «ne sont pas les valeurs de la France». Et qui ne craignent pas de dénoncer avec vigueur le «Front anti-national». Bref, on rejoue l'opposition mythique entre les deux France, la bonne (ici l'anti-lepéniste) et la mauvaise (ici la «lepénisée»). À travers ce retour du réprimé national après transvaluation intéressée, le nationalisme se venge. Non sans ironie objective.
Vous dites que le FN n'est plus d'extrême droite. Doit-on se débarrasser définitivement de la catégorie «extrême droite» dans l'analyse politique?
Je suis plus nuancé. Et aussi trop peu naïf pour croire qu'on puisse se passer, selon notre bon plaisir d'intellectuels critiques, des idées reçues, des habitudes de pensée et des stéréotypes sans lesquels la communication politique serait impossible. Je montre d'abord que l'expression «extrême droite» fonctionne comme une étiquette polémique, destinée à disqualifier un adversaire, et qu'elle enveloppe une notion confuse. Elle n'est pas le produit de la conceptualisation rigoureuse d'un phénomène politique bien identifié, mais une expression douteuse reçue en héritage et reprise sans examen critique. À l'analyse, on se rend vite compte qu'elle fonctionne comme un quasi-synonyme de «fascisme», avec la suggestion trompeuse que le fascisme serait intrinsèquement de droite ou essentiellement situé à droite, ou, selon le cliché actuellement en vogue, «à droite de la droite». La pensée paresseuse consiste à qualifier de «fascistes» ceux qu'on perçoit comme des ennemis: les nationalistes pour les antinationalistes, les islamistes pour les anti-islamistes, etc. Le mot est mis à toutes les sauces, et il n'éclaire en rien les phénomènes qu'on veut avant tout stigmatiser. C'est là faire l'économie d'un travail intellectuel difficile sur les catégorisations historiques et politiques, impliquant de se passer des outils ordinaires du discours polémique. Car il n'est pas question de jeter aux orties le mot «fascisme», en raison de ses mauvais usages. Il s'agit de le définir de la façon la plus rigoureuse, en sachant qu'on ne peut satisfaire tous les spécialistes, ni bien sûr les «antifascistes» (qui, eux, croient tout savoir sur la question). Disons, pour aller vite, et en privilégiant les critères doctrinaux, qu'il s'agit d'un nationalisme d'orientation révolutionnaire, anti-libéral, autoritaire et étatiste (ou dirigiste), prônant un socialisme dans les limites de la nation, à tendance totalitaire, et susceptible de prendre des formes historiques diverses. Le situer «à droite» ne permet pas de mieux identifier ou expliquer le phénomène fasciste, bien au contraire. Ce dernier apparaît plutôt comme un produit pathologique dérivé de la gauche révolutionnaire, lorsqu'elle épouse les passions nationalistes. C'est en tout cas ce que suggère la trajectoire intellectuelle et politique de Mussolini. Ce qui est sûr, c'est que, dans l'expression «extrême droite», le qualificatif «extrême» est dénué d'une signification claire et invariable. Il s'agit d'une image interprétable de diverses manières. Cela suffit à rendre son emploi douteux, source d'équivoques. L'appartenance supposée de «l'extrême droite» à la droite est à la fois une idée reçue et une idée fausse.
Comment qualifier désormais le parti de Marine Le Pen?
Il s'agit toujours d'un parti nationaliste, à la fois souverainiste et identitaire, donc anti-européiste, «antimondialiste» et anti-immigration, dont le leader se caractérise par son style populiste, jumelant l'appel au peuple, le culte du peuple et le rejet des élites en place. En 1984, j'ai proposé de le catégoriser comme «national-populiste», et je pense que cette catégorisation est toujours la moins mauvaise. Mais il faut tenir compte de la grande transformation du programme de ce parti, dont le contenu idéologique a été modifié par intégration de thèmes ou d'orientations empruntés à la gauche républicaine (la laïcité par exemple) ou à l'extrême gauche anticapitaliste (la dénonciation du «néo-libéralisme»). Dans ces conditions, il faut reposer les questions simples, certes avec une feinte naïveté: pourquoi continuer à situer le FN «à droite»? En quoi peut-il être dit extrémiste? Qu'est-ce que l'extrémisme? Et qu'est-ce que «l'extrême droite»? Dans Du diable en politique, je m'efforce de répondre à ces questions que les leaders politiques et les commentateurs de la vie politique se gardent de poser. Ils savent obscurément qu'ils ne peuvent y répondre clairement et d'une seule voix.
Vous parlez d'un «parti de la peur». Mais à vous lire, jouer sur les peurs n'est pas le monopole du Front National...
La politique de la peur est la norme implicite régissant les affrontements politiques. Les peurs les plus contradictoires dominent le paysage politique, tandis qu'un sentiment polymorphe d'insécurité colore le champ de l'imaginaire social. C'est ainsi qu'à la peur d'une immigration de masse répond celle d'une xénophobie de masse. Mais c'est la peur de perdre quelque chose qui donne le ton. De l'identité nationale aux acquis sociaux. Par peur de sortir du jeu, les acteurs politiques font un usage démagogique des peurs plutôt que des rêves. Les uns jouent sur la peur de l'effondrement de l'euro, les autres sur la peur d'une sortie de l'euro, d'autres encore sur la peur des effets négatifs de l'euro. Comme la peur du «terrorisme» ou de la «finance», la peur de «l'extrême droite» ou de «l'extrémisme» est une passion alimentée, entretenue ou réveillée par ceux qui ont intérêt à l'exploiter. C'est ainsi que les Français apeurés sont traités par les nouveaux démagogues comme une masse de petits vieux jouisseurs, sans convictions ni projets, vulnérables, sans courage, tiraillés par des peurs contradictoires, oscillant entre une crédulité infantile et un scepticisme incapacitant. Le mépris du citoyen est l'effet immédiat de la corruption de la démocratie par des élites dirigeantes élues grâce à leurs talents démagogiques avant de gouverner en orchestrant un mélange de craintes et d'espoirs.
La diabolisation ne semble pas toucher uniquement le FN, mais quiconque «dérape» sur le chemin du politiquement correct. L'information continue semble accélérer la mécanique diabolisatrice et nous offrir chaque semaine un nouveau diable médiatique: un jour Zemmour, l'autre Finkielkraut, ou encore récemment le député Thierry Mariani… Selon vous, ce phénomène va-t-il s'amplifier?
Des années 1990 aux années 2010, le discours néo-antifasciste est passé de la dénonciation de la «lepénisation des esprits» à celle de la «droitisation» des élites intellectuelles et politiques, accusation vague permettant de discréditer n'importe quel adversaire ou rival. Le terrorisme intellectuel reste cependant l'apanage de la gauche et de l'extrême gauche, qui peuvent compter sur l'appui des «modérés» du centre et de la droite opportuniste. Plus l'espace des débats est dominé par le culte du consensus minimal sur le bon fonctionnement des institutions démocratiques et les bienfaits de l'Union européenne, et plus s'exacerbe le besoin de créer des distinctions, des oppositions, des alternatives. L'uniformisation idéologique est le bruit de fond sur lequel se détache la petite musique des mouvements souverainistes et identitaires, qui restent minoritaires. Mais les réactions des défenseurs de la Voie unique sont vives. La moindre réserve sur les positions politiquement correctes concernant l'Europe, l'immigration ou les minorités est perçue comme une opinion abjecte, voire un délit, qui suscite une indignation hyperbolique et, de plus ou plus souvent, des poursuites devant les tribunaux. Dans une France sous l'emprise des minorités sectaires et tyranniques qui imposent leurs valeurs et leurs normes, l'espace public s'empoisonne lentement. Les débats s'enlisent dans les échanges de clichés et de platitudes. L'auto-censure est de rigueur dans une société de surveillance réciproque. Les esprits libres se gardent de participer aux débats publics, abandonnant le terrain médiatique à de grotesques personnages incultes ou à demi cultivés, histrions littéraires, amuseurs engagés ou commissaires politiques qui n'existent que par l'insulte, l'indignation feinte, l'imprécation ou la provocation. J'oubliais les donneurs de leçons de tous âges. Quand des esprits libres prennent le risque de descendre dans l'arène, ils sont immanquablement voués à être dénoncés, calomniés, diffamés. La menace de diabolisation produit une intimidation telle qu'elle garantit la promotion de la médiocrité. Seuls des «experts» sans couleur ni odeur prolifèrent dans le paysage. C'est ainsi que s'accélère le déclin de la France intellectuelle.
À vous lire, on a parfois l'impression que vous voyez la vie politique comme un spectacle où des comédiens plus ou moins doués font carrière à coup de mensonges et de promesses intenables. Les leaders politiques ne sont-ils que des démagogues sans scrupules?
Si les démagogues sont nombreux, les médiocres sont encore plus nombreux, qu'ils soient démagogues ou non. Dans les démocraties modernes, les démagogues prennent souvent le visage de faux prophètes, annonçant de grands «changements» porteurs de promesses alléchantes. Comment peut-on ne pas se soucier de plaire lorsqu'on s'engage dans une compétition électorale? Il y a là une contrainte fonctionnelle: l'obligation de séduire pousse à trop promettre, à beaucoup mentir et à calomnier ses adversaires. Aujourd'hui, se nourrissant du désarroi et de l'anxiété suscités par la crise multidimensionnelle, de dérisoires prophètes de bonheur ou de malheur prolifèrent, dans tous les domaines, mais surtout en politique. La sagesse pratique consiste à se garder de les prendre au sérieux. Les plus dangereux sont les prophètes de bonheur, ces camelots qui, au nom du dieu «Progrès», vantent et vendent un quelconque avenir meilleur, alors que le piteux état du présent porte l'empreinte de leur impuissance ou de leur incompétence. Face aux marchands de mondes meilleurs («Demain, tout ira bien»), c'est avec l'ironie requise qu'il faut suivre l'injonction de l'évangéliste Matthieu (7.15-16), d'une éternelle actualité: «Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons?» Il faut donc juger les dirigeants sur les résultats de leur action politique, et non pas sur leur charme personnel, leurs intentions bonnes ou leurs projets séduisants.
Pierre-André Taguieff (FigaroVox, 23 mai 2014)